La corrosion des armatures en béton armé suscite de nombreuses questions, notamment concernant la durabilité des ouvrages. En tant que professionnels du secteur, vous cherchez des solutions concrètes et durables pour protéger vos structures ? Dans le webinaire « La protection cathodique dans le traitement de la corrosion des armatures », Nicolas Chaignon, chef de marché gros œuvre chez Sika France, et Stéphane Panin, président de R3S France, vous apportent des éclairages précis sur les mécanismes de dégradation du béton armé et partagent des stratégies efficaces pour la réparation et la préservation des structures.
Question : Quels sont les enjeux de réparation des ouvrages en béton armé ?. 2
Question : Quelles sont les causes principales de la dégradation du béton armé ?. 2
Question : Qu'est-ce que la carbonatation du béton et comment la traiter ?. 3
Question : Quelles sont les solutions pour prévenir la carbonatation ?. 4
Question : Corrosion des armatures en béton armé, par quoi commencer ?. 4
Question : Quelles sont les étapes d'un diagnostic corrosion ?. 4
Pour en savoir plus sur la prévention et le traitement de la corrosion. 5
Quels sont les enjeux de réparation des ouvrages en béton armé ?
Pour bien comprendre les enjeux de la dégradation du béton armé, il faut remonter 70 ans en arrière. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’utilisation massive du béton dans la construction était systématique. L'urbanisme moderne de l'après-guerre reposait sur des solutions constructives conçues pour durer environ 50 ans. Une fois cette durée atteinte, les solutions envisagées étaient tout simplement la démolition et la reconstruction.
Ces solutions sont désormais incompatibles avec les préoccupations actuelles. En effet, l'épuisement des ressources naturelles, la pénurie de sable, les problèmes d'approvisionnement en eau potable, l'augmentation du prix de l'énergie, les nouvelles réglementations et la gestion des déchets rendent cette approche impossible.
Répondre aux enjeux environnementaux actuels implique de réutiliser et de prolonger la durée de vie des ouvrages existants, offrant ainsi une alternative plus durable et respectueuse de l'environnement.
Quelles sont les causes principales de la dégradation du béton armé ?
Le béton, malgré sa robustesse et sa polyvalence, peut être sujet à diverses pathologies internes ou externes qui affectent sa durabilité et sa performance structurelle.
Corrosion des armatures
La corrosion des armatures en acier est l'une des pathologies les plus courantes. La corrosion des armatures en acier se produit lorsque les chlorures ou le dioxyde de carbone pénètrent le béton et atteignent les armatures, causant leur oxydation. Cette oxydation provoque une augmentation de volume, créant des fissures dans le béton qui compromettent sa capacité structurelle et sa durabilité.
Réaction alcali-granulat (RAG)
La réaction alcali-granulat (RAG) est une réaction chimique entre les alcalis du ciment et certains types de granulats. Cette réaction entre les alcalis du ciment et les granulats forme un gel expansif qui absorbe l'eau, entraînant des fissurations et un gonflement du béton. Les structures touchées peuvent perdre leur intégrité.
Attaques chimiques
Le béton peut être endommagé par des attaques chimiques provenant de l'environnement, telles que les acides, les sulfates et les chlorures. Les acides peuvent dissoudre la pâte de ciment, tandis que les sulfates peuvent réagir avec les composants du béton pour former des composés expansifs, comme l'ettringite, qui provoquent des fissures.
Carbonatation
La carbonatation est un processus naturel où le dioxyde de carbone de l'air réagit avec l'hydroxyde de calcium dans le béton pour former du carbonate de calcium. Ce processus abaisse le pH du béton, réduisant la protection des armatures en acier contre la corrosion. Avec le temps, cela peut conduire à une corrosion accélérée des armatures et à des fissurations.
Gel - dégel
Les cycles de gel-dégel sont particulièrement problématiques, car ils fragilisent le béton exposé aux climats froids. L'eau pénétrant dans les pores du béton peut en effet geler et se dilater, provoquant des gonflements du béton à cœur et des fissurations en surface. Ces cycles conduisent à une diminution des propriétés mécaniques du béton, réduisant ainsi la durée de vie des ouvrages affectés.
Qu'est-ce que la carbonatation du béton et comment la traiter ?
La carbonatation du béton est un phénomène chimique où le dioxyde de carbone (CO2) de l'air réagit avec l'hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) dans le béton. Bien que cette réaction chimique puisse offrir une protection naturelle contre la pénétration des gaz et des liquides, elle peut également causer des dommages importants aux structures en béton armé.
En effet, la carbonatation réduit l'alcalinité du béton, faisant chuter son pH de 13 à environ 9. Cette baisse de pH expose les armatures à la corrosion. Une réaction électrochimique se produit entre les zones à faible pH (anode) et les zones protégées (cathode). La corrosion de l'acier entraîne la formation de rouille, qui occupe un volume beaucoup plus important que l'acier non corrodé. Cela provoque des fissures et des éclatements du béton, réduisant ainsi la section des armatures et la capacité portante de la structure.
Quelles sont les solutions pour prévenir la carbonatation ?
Pour assurer la durabilité des structures en béton armé, il est indispensable de prévenir et maîtriser la corrosion active des armatures. Plusieurs traitements existent pour protéger efficacement les armatures contre la pénétration des agents agressifs.
Réparation traditionnelle et localisée avec la passivation des aciers
Dans le cas de corrosions modérées, il s’agit de remplacer le béton d’enrobage endommagé par zones localisées. Une fois la corrosion éliminée, la passivation des aciers est réalisée par l’application d’un produit conforme à la norme EN 1504-7 puis recouverte d’un mortier de réparation conforme à la norme EN 1504-3.
Traitements électrochimiques
Pour une meilleure protection, il est possible d’agir directement sur les propriétés du béton pour restituer au ferraillage son milieu protecteur d’origine. Deux types de traitement existent : la réalcalinisation et la déchloruration.
Protection cathodique
La protection cathodique est une méthode proactive pour gérer la corrosion des structures en béton armé. Elle offre une double fonction : protéger les armatures contre la corrosion et contrôler ce phénomène en agissant directement sur les composants métalliques.
Ces trois méthodes sont complémentaires les unes des autres et peuvent être utilisées ensemble selon le niveau de protection souhaité.
Visionnez notre webinaire
« La protection cathodique dans le traitement de la corrosion des armatures »
Corrosion des armatures en béton armé, par quoi commencer ?
Réaliser un diagnostic spécifique du béton est indispensable dès l'apparition des premiers signes de corrosion. Celui-ci permet de localiser précisément les dégradations et d'identifier les causes sous-jacentes. En analysant la présence des fissures, le gonflement du béton, ou les armatures corrodées, le diagnostic fournit une image précise de la gravité des désordres et permet de définir les solutions de réparation les plus adaptées. En outre, un diagnostic corrosion apporte tous les éléments permettant de décider et d’estimer le coût des futurs travaux.
Quelles sont les étapes d'un diagnostic corrosion ?
Pour assurer une évaluation complète et précise des dommages causés par la corrosion, un diagnostic approfondi se déroule en plusieurs étapes.
- Étude documentaire : il s’agit d’examiner les documents et l'historique de l'ouvrage. Les plans et cahiers des charges, lorsqu'ils sont disponibles, fournissent des informations précieuses sur la construction initiale et les travaux de réhabilitation antérieurs.
- Inspection visuelle : la seconde étape implique une inspection visuelle de la structure. Cette évaluation préliminaire permet de détecter les désordres, d'estimer leur évolution et de recommander des mesures d'urgence si nécessaire. Un rapport de synthèse est ensuite établi pour documenter les observations.
- Diagnostic structurel : la dernière étape consiste à utiliser des sondages destructifs et non destructifs. Différents types de sondages permettent d’obtenir des paramètres utiles à la conception : carottage du béton, mesure de la teneur en chlorure et en sulfate, profondeur de carbonatation, analyse des zones anodiques et cathodiques, et mesures de résistivité du béton.
Pour en savoir plus sur la prévention et le traitement de la corrosion
Notre livre blanc en pdf
Consultez notre livre blanc « Traiter la corrosion des ouvrages en béton armé » et visualisez notre webinaire « La protection cathodique dans le traitement de la corrosion des armatures ».
A lire aussi : Comment réparer un béton dégradé avec les fers apparents (passivation des fers à béton) ?




-ACTUALITE MOBILE (394 x 302 px) (305 x 350 px) (394 x 302 px) (343 x 231 px).png)
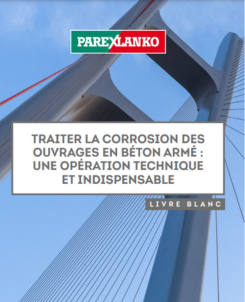
-Articles - desktop.png)

-Articles - desktop (1).png)